- The PaperNiveau 10
Je profite de ce sujet pour vous inviter à télécharger cet ebook où je réponds à 35 questions que les élèves me posent tous les ans :
Questions à propos du bac général de français
(Téléchargement gratuit jusqu'à samedi ; ensuite je dois mettre un prix minimum).
Comme j'y aborde des décalages entre tradition pédagogique et instructions officielles, peut-être que cela suscitera des débats. Plusieurs fois, j'ai indiqué ce que je recommandais de faire tout en précisant que ce n'était pas obligatoire d'après les I.O.
Je suis déjà rassuré de voir que plusieurs de mes collègues vont l'utiliser avec leurs classes pour éviter d'avoir à répéter sans arrêt les mêmes points de méthode, mais si vous êtes en désaccord avec un point, dites-le moi, qu'on en discute.
Au plaisir de vous lire.
Questions à propos du bac général de français
(Téléchargement gratuit jusqu'à samedi ; ensuite je dois mettre un prix minimum).
Comme j'y aborde des décalages entre tradition pédagogique et instructions officielles, peut-être que cela suscitera des débats. Plusieurs fois, j'ai indiqué ce que je recommandais de faire tout en précisant que ce n'était pas obligatoire d'après les I.O.
Je suis déjà rassuré de voir que plusieurs de mes collègues vont l'utiliser avec leurs classes pour éviter d'avoir à répéter sans arrêt les mêmes points de méthode, mais si vous êtes en désaccord avec un point, dites-le moi, qu'on en discute.
Au plaisir de vous lire.
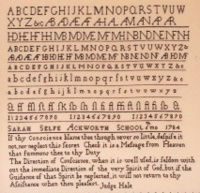 nicole 86Expert spécialisé
nicole 86Expert spécialisé
Je viens de le télécharger pour mes petits enfants, je le lirai très vite à tête reposée, merci.
 The PaperNiveau 10
The PaperNiveau 10
Aujourd'hui on m'a posé une question que je n'ai pas mise dans le document : est-ce qu'au moment de dire notre lecture linéaire, on a droit aux notes qu'on a prises pendant les trente minutes ? 
La liste s'allonge tous les ans !
La question peut sembler bête mais on vit dans un monde où il y a tellement de choses absurdes que ça n'est pas si bête que ça, finalement. D'ailleurs, il me semble qu'au grand oral des Terminales, il y a quelques années, les candidats n'avaient pas droit aux notes de la préparation qu'ils venaient de faire...

La liste s'allonge tous les ans !
La question peut sembler bête mais on vit dans un monde où il y a tellement de choses absurdes que ça n'est pas si bête que ça, finalement. D'ailleurs, il me semble qu'au grand oral des Terminales, il y a quelques années, les candidats n'avaient pas droit aux notes de la préparation qu'ils venaient de faire...
_________________
- Publicité:
- Etude de "Manon Lescaut" https://www.amazon.fr/dp/B0B8BM227F
"Cahier de Douai" + étude https://www.amazon.fr/dp/B0CF4CWMPH
Etude du "Malade imaginaire" https://www.amazon.fr/dp/B08D54RDYF
Etude de la "Déclaration des droits de la femme" : https://www.amazon.fr/dp/B09B7DHTXP
"Bataille de dames" + étude https://www.amazon.fr/dp/B09FC7XCW4
"Bisclavret" et "Le laüstic" + dossier sur le loup https://www.amazon.fr/dp/B0CGL84111
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum




